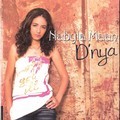Qu’entendez-vous derrière le concept de marginalité urbaine ?
En sociologie urbaine, on définit la marginalité par trois choses : la première se rapporte à l’Etat. Très souvent, les lieux de marginalité urbaine ont un statut administratif, juridique et politique très particulier. Pour le bidonville, qui est le grand foyer de marginalité urbaine qu’on connaissait au Maroc il y a quelques années encore, c’est la question de la propriété qui se posait. Les bidonvillois n’avaient pas de titre de propriété de l’espace sur lequel ils habitaient. C’est également vrai pour une certaine partie des douars périurbains sur lesquels la ville a progressé.
En matière de relogement périurbain, c’est-à-dire des bidonvilles relogés en périphérie de la ville dans des immeubles de taille moyenne, les relogements ont été réalisés dans des communes rurales. Cela a changé beaucoup de choses dans la vie concrète de ces gens. Le statut de «commune rurale» implique par exemple l’absence des pouvoirs publics (police, hôpitaux, dispensaires, etc.) dans des communes à importante densité d’habitants. Lahraouine par exemple, où ont été relogés les habitants du bidonville historique des Carrières centrales, dépend ainsi de Mediouna, à trente kilomètres de Casablanca alors même que le quartier est dans le voisinage immédiat de la ville.
Ensuite, il y a la question du marché. La marginalité urbaine correspond effectivement à une position de la marge par rapport au marché, aux dispositions économiques au sein de l’espace social. Pour les bidonvilles,même s’il s’agissait de lieux de pauvreté, ils étaient souvent inscrits dans le tissu économique des quartiers ouvriers de la ville, comme pour le cas des Carrières centrales au cœur du Hay Mohammadi. A l’inverse, l’extrême éloignement des populations relogées à Lahraouine ne leur permet plus d’avoir un emploi régulier. Ce n’est plus possible pour elles de maintenir une régularité dans le travail : il n’y a quasiment pas de bus, les taxis rouges ne vont pas jusque là-bas, les taxis blancs à peine… Pour se déplacer, ces gens doivent prendre plusieurs taxis, effectuer une partie du trajet en bus, ou même à dos d’âne. Ils sont contraints de se reconvertir dans le secteur de l’aide à la personne, sous sa forme la plus précaire. Par exemple, les femmes de ménage alimentent ainsi les «mawqef», ces marchés de travailleurs journaliers où la violence sociale est la plus forte.
Enfin, la question la plus importante renvoie à une dimension symbolique, c’est-à-dire les stigmates qui sont portés sur un certain groupe social. Celui qui pèse sur les bidonvillois, par exemple, c’est la saleté. Dans l’imaginaire collectif, les bidonvilles sont synonymes de saleté, de violence et d’émeutes, comme c’est le cas à Hay Mohammadi, emblématique de Casablanca. Il y a eu les émeutes de juin 1981 puis les attentats terroristes en 2003, dont les auteurs étaient originaires de Sidi Moumen. Ces évènements ont suffi à stigmatiser l’ensemble de ces habitations et leurs habitants. Le programme «Villes sans bidonvilles», sur lequel le Maroc est considéré comme un pays pionnier par l’ONU, a eu comme justification, en partie, la lutte contre le terrorisme.
Comment se traduit cette marginalité auprès de ces populations ?
Elles sont invisibilisées ; elles n’existent plus dans la ville. L’une des premières revendications des gens qui ont été relogés, c’est qu’on leur reconnaisse leur qualité d’urbains. Ils sont à Casablanca depuis trois générations, alors que parallèlement, on légitime souvent leur relogement à l’extérieur de la ville par le fait qu’ils seraient le produit d’un exode rural, ce qui est faux. En réalité, ils sont là depuis très longtemps. Parler d’où ils viennent, ça n’a pas de sens : ils viennent de Casablanca.
Quelles sont les caractéristiques de ces quartiers ?
Il faut revenir à la manière dont s’est construit Lahraouine. Le programme «Villes sans bidonvilles» s’est généralement fait via des partenariats publics-privés avec les grands consortiums immobiliers du pays. Pour le cas de Lahraouine, c’est encore plus «pervers» si je puis dire : cela s’est fait à travers des tous petits entrepreneurs privés. Les autorités locales, en l’occurrence le moqadem, désignent qui va habiter dans le quartier nouvellement construit, se basant sur ceux qui habitaient selon lui au bidonville. Evidemment, cela lui donne un pouvoir énorme. On va alors leur attribuer un lotissement dans une commune rurale, comme Lahraouine, et leur demander de trouver eux-mêmes un investisseur qui va construire. Les familles se mettent à deux pour le trouver. Puis, une fois que le lotissement est attribué, l’Etat se met en retrait complet.
Par la suite, la relation pour aboutir au relogement se fait entre l’investisseur et le bidonvillois. Comme ce sont de tous petits investisseurs, le nombre de faillites est particulièrement élevé. Quand vous marchez dans les rues, vous voyez des immeubles de trois appartements qui n’ont pas de façades, seulement des bâches et des cloisons qui assurent la tenue du bâtiment. Il n’y a aucune intimité ou protection d'aucune sorte. C’est une conséquence directe des modalités de relogement : ce n’est pas un relogement via l’Etat, qui s’est simplement contenté de donner le lotissement, mais un relogement dont la gestion est confiée à des gens qui n’ont pas beaucoup de capitaux. Ils ont commencé une opération immobilière qu’ils n’ont pas les moyens de finir ; en somme, ils ont eu le ventre plus gros que les yeux.
Surtout, tout ça montre que la gestion des bidonvilles par le Maroc, soit le programme «Villes sans bidonvilles», est en fait une lutte contre l’existence de ces bidonvilles-là dans la ville. L’objectif, c’est de les faire sortir de la ville, pas de faire disparaître la marginalité urbaine. Pourquoi, à un moment donné, décide-t-on que les pauvres ne doivent plus habiter dans la ville, mais à la périphérie ? C’est ça qui pose question. Le Maroc a tout simplement décidé d’extraire les pauvres du centre de la ville pour les installer en périphérie. On a donc simplement fondé des ghettos…
Ce qui ne va certainement pas aider à la lutte contre la radicalisation et la délinquance…
Absolument pas, au contraire. Les bidonvilles profitaient, malgré tout, d’un certain nombre de circulations économiques qui existaient dans la ville. Celui des Carrières centrales, qui se situe à Hay Mohammadi, un quartier populaire mais avec une activité économique et industrielle importante, est un exemple. C’est celui-là qui a été relogé à Lahraouine.
Il y avait une vraie entraide économique au sein du bidonville, les gens étaient là les uns pour les autres, notamment dans les cas de rupture sociale, lorsque la famille est désarticulée. La gestion des enfants se fait alors collectivement, ainsi que tout un certain nombre d’entraides sociales. Tout ça a été complètement brisé à cause de ce relogement. La marginalité urbaine dont je parle - il y en a plusieurs - est celle d’un processus qui a vu se transformer la marginalité du bidonville en une autre forme de marginalité ; celle du ghetto, en dehors de la ville.




 chargement...
chargement...