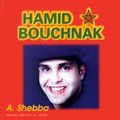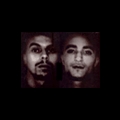La colonisation, dès 1830, de l’Algérie et du protectorat sur la Tunisie en 1881 puis sur le Maroc en 1912 par la France ont été un processus truffé de stratégies et plans visant à diviser pour mieux régner. Ainsi, en octobre 1870, les autorités françaises adoptent le «Décret Crémieux», qui naturalise les «indigènes israélites».
Dix ans plus tôt, la très influenceuse Alliance Israélite Universelle (AIU) mettait déjà le cap sur le Maroc, en ouvrant d’abord à Tétouan puis dans plusieurs autres villes, des écoles destinées aux communautés juives. Leur mission était alors d’enseigner aux juifs du Maroc des valeurs de l’Occident, tout en veillant à une éducation religieuse traditionnelle des principes du judaïsme.
Appliquer le «Décret Crémieux» au Maroc
Et avec l’arrivée du protectorat en 1912, la population juive du Maroc, formée de juifs d’origine amazighe et de descendants de juifs expulsés d’Espagne à l’époque de la Reconquista, était alors majoritairement urbanisée. Dans ce sens, en 1920, la France et l’Espagne lancent alors un processus de réflexion pour la naturalisation des juifs du Maroc, à l’image de la politique menée quelques années plus tôt en Algérie.
Dans «Les juifs des protectorats marocains dans les années 1920 : La question de la naturalisation», publié dans le numéro 20 de la revue Hispania Nova, la chercheuse Eva Touboul revient sur cette question, racontant comment Yomtob Semach, représentant de l’AIU au Maroc, était l’un des partisans de cette naturalisation massive des juifs du Maroc. Dans ce sens, en 1927, il racontait qu’après 15 ans de présence française à travers le Protectorat, «plus rien ne différencie les juifs des Européens». «Le juif ne tient nullement à son statut personnel, ses principes religieux peuvent s’accommoder des lois civiles communes à tous, il ne demande qu’à se confondre avec la masse des citoyens», écrit-il.
Quant à l’Espagne, également intéressée à l’époque par cette naturalisation, l’un des objectifs était «d’attirer (…) un secteur de la population locale qui occupe une place importante dans la structure économique locale», poursuit la chercheuse.
Mais à la base, «le parallélisme avec l’Algérie n’était pas tout à fait pertinent». Si «les questions de naturalisation collective ou non des différents secteurs de la population ne concernaient finalement que l’administration française» en Algérie, la France a fait face au Maroc à l’administration nationale marocaine, qui avait régulièrement essayé de défendre son autorité, rappelle-t-elle.
La réticence de Paris et la discrétion de Madrid
Finalement, les autorités espagnoles et françaises étaient restées «globalement réticentes» à l’idée d’imiter l’expérience du «Décret Crémieux» et ce, pour des raisons différentes. Pour la France, ce texte n’a pas permis à Paris de résoudre les problèmes en Algérie mais bien au contraire. En effet, le décret avait exclu «de nombreux juifs» établis en Algérie, à savoir les Marocains, les Tunisiens et les Mozabites.
De plus, il avait suscité la colère des traditionnalistes juifs mais aussi des musulmans, pointant le risque d’un déséquilibre statutaire au sein de la population. La même période a également été marquée par des «flambées d’antisémitisme» à Oran et à Alger. Eva Touboul indique aussi que le Maréchal Lyautey, Résident Général de 1912 à 1925 était également contre l’idée d’une naturalisation massive des juifs du Maroc.
Quant à l’Espagne, le Directoire militaire du général Primo de Rivera avait franchi le pays, en promulguant, en décembre 1924, un Décret qui permettait aux Sépharades de demander la nationalité espagnole. Un texte qui crée ainsi une «différence de statut» entre les descendants des juifs espagnols expulsés et les juifs arabes et amazighs. Le texte restera toutefois méconnu pour les juifs du Maroc, l’Espagne ayant craint un engouement auquel elle n’était pas en mesure de faire face.
Les deux puissances opteront pour la naturalisation discrète de quelques juifs seulement. Des campagnes en faveur d’une naturalisation massive des juifs ont pourtant été lancées en Espagne tout comme en France, sans parvenir à convaincre Madrid et Paris. La Guerre du Rif, la résistance nationale ainsi que les révoltes des tribus avaient constitué à l’époque, des vraies sources de préoccupation pour les deux Etats, reléguant ce dossier de statut des juifs à la seconde place.
C’est d’ailleurs l’un des points qui permettront au sionisme de gagner du terrain au Maroc, parvenant même à séduire, plus tard, des milliers de juifs marocains qui choisiront d’émigrer en Israël, sous la supervision du Mossad. La proclamation de l’Etat d’Israël en 1948 et les événements de l’Oriental, les 7 et 8 juin de la même année, ne feront qu’accélérer cet exode vers la Palestine qui s’établera sur plusieurs années.




 chargement...
chargement...