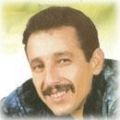Le cri de détresse lancé, le mois dernier, par des associatifs de la région sur la situation de la Moulouya, l’un des plus grands fleuves du Maroc, vient d’être renforcé par une nouvelle étude scientifique. Réalisée par sept chercheurs de l’Université Mohammed 1er d’Oujda et de la Faculté pluridisciplinaire de Taza, elle s’est intéressée au bassin versant de la Moulouya.
Les chercheurs marocains ont ainsi cartographié les pertes de sol, en déterminant un modèle adopté qui montre l'érosivité des précipitations, l'érodabilité du sol, l'inclinaison et la longueur de la pente, la couverture du sol et les pratiques de contrôle de l'érosion. «L'intensité des précipitations, les pentes abruptes et la déforestation sont responsables de ces pertes», expliquent-ils, en pointant ainsi «les risques élevés d'érosion hydrique» du bassin du fleuve marocain. De plus, ils ajoutent, plus loin, que les barrages construits sur cette rivière «perdent chaque année, par envasement» plusieurs millions de mètres cubes, à un «taux inquiétant qui montre que l'érosion hydrique peut entraver le développement socio-économique du bassin si des mesures de protection des sols et d'envasement ne sont pas prises».
«L'érosion hydrique dans le bassin versant de la Moulouya a entraîné de profonds changements dans divers domaines économiques, sociaux et environnementaux. Elle a conduit à l'émergence de problèmes qui ne peuvent être atténués que par des mesures intégrées garantissant une vie décente à la population et préservant les ressources naturelles et la durabilité pour les générations futures.»
En d’autres mots, «les précipitations excessives et violentes, le déclin et la dégradation du couvert végétal ainsi que la surexploitation des pâturages et de l'agriculture contribuent à accroître la vulnérabilité et à accélérer le développement de la dynamique d'érosion hydrique». «Le sol se détériore constamment en raison de la nature rocheuse de la région et des conditions naturelles de sécheresse, aggravées par des systèmes inadéquats d'exploitation humaine et de dégradation», précisent les chercheurs, affirmant en outre que «des changements récents dans l'utilisation des terres ont modifié la distribution spatiale des zones d'alimentation en sédiments».
Absence d’une approche globale prenant en compte les besoins et exigences de la population
Pour l’étude, «les formes de dégradation prévalent en l'absence d'une approche globale prenant en compte les besoins et exigences de la population rurale, dont l'absence dans les projets et programmes de développement constitue un tournant majeur pour les composantes naturelles et leur importance pour la préservation des ressources naturelles et leur pérennité».
Ses rédacteurs citent également «les taux d'envasement élevés des barrages Mechrâa Hammadi (1958) et Mohammed V (1967) (à cause de l'érosion intense dans le bassin) et qui affectent l'irrigation de la basse Moulouya et l'alimentation en eau potable des principales villes et centres urbains de Nord-est du Maroc». L’étude rappelle à cet égard que l'envasement du barrage Mohammed V depuis 1967 a fait perdre au barrage 67% de sa capacité de retenue.
En octobre dernier, et après plusieurs alertes lancées par les défenseurs de l’environnement dans la région, le lien entre l'embouchure de la Moulouya, qui dessert une partie du Maroc oriental et la mer Méditerranée a été rompu pour la première fois. Les activistes ont ainsi publié, les images d’un cordon sableux qui sépare désormais l'embouchure de la mer, dénonçant un drame écologique.
Cette semaine, plusieurs associations ont exprimé leur inquiétude sur le devenir de la zone humide de l’embouchure du fleuve. «De nombreuses études scientifiques réalisées dans le site ont démontré, sans équivoque, une détérioration de sa biodiversité et plusieurs habitats et espèces ont atteint un stade de dégradation très avancée. Parmi les signes du changement de cet écosystème on peut noter l'augmentation du taux de salinité des eaux superficielles et souterraines, disparition de la plus grande forêt littorale Tazegraret, en quelques années seulement, dépérissement des arbres de Genévrier rouge, érosion avancée du rivage et disparition de la dune, assèchement du marécage de Chrarba et du bras mort de la Moulouya», déplorent-elles.




 chargement...
chargement...