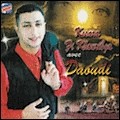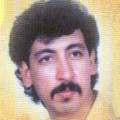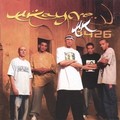Les illustrations en la matière sont légion et grossissent au fur et à mesure des journées qui s’écoulent en traînant la patte comme une tortue :
• Les femmes subissent davantage la charge mentale car elles doivent faire preuve de polyvalence encore plus accrue qu’à l’accoutumée pour gérer de main de maîtresse les multiples fonctions (non rémunérées) qui leur pleuvent dessus. Pour certaines avec le lot des violences psychologiques et physiques qui ont repris du galon.
• Les familles précarisées sont en proie au confinement dans des espaces de logement réduit, des problèmes financiers exacerbés et/ou de faibles ressources culturelles. Sur les réseaux sociaux s’étalent pourtant des milliers d’idées de bricolages, d’ateliers cuisine, d’exercices de gymnastique… à exécuter durant l’enfermement de la crise sanitaire. Initiatives très louables mais fort peu praticables lorsqu’on s’entasse dans un appartement sans le moindre centimètre d’espace vert ou de courette pour s’aérer.
• Les personnes isolées et vieillissantes sont rongées, plus qu’à l’accoutumée, par la solitude devant un minuscule organisme viral dont on tente de les préserver au prix le plus fort : la privation des visites de leurs enfants et petits-enfants.
• Et que dire des personnes sans-abri sommées de rentrer «chez elle», injonction à laquelle elles ne peuvent obéir vu que leur plafond se résume à l’immensité du ciel ?
• Que dire encore des personnes handicapées et de leurs proches qui sont plus durement frappées en l’absence de contacts avec les professionnels, de moments de répit pour les leurs ?
Il y a une foultitude d’autres groupes de population qui pourraient aussi être évoqués, chose impossible en l’espace de quelques signes sous la forme de cette modeste tribune. Cependant, sans doute par le double parcours migratoire qui a caractérisé ma vie, je ne peux m’empêcher de poser un regard sur les personnes immigrées ou issues de l’immigration.
Que donne-t-il à voir à partir de quelques lectures, échanges téléphoniques avec des ami.e.s, informations qui reviennent au-travers des écrans sous toutes leurs formes ? Quelques images de reportages, des récits et témoignages dont on peut citer pêle-mêle : un homme sorti d’un coma artificiel apprend que sa maman, décédée du Covid-19, a été enterrée en région bruxelloise alors que son souhait était de voir sa dépouille reposer au Maroc, son pays d’origine ; une telle autre ne peut assister à l’enterrement de son enfant car elle est restée bloquée à Tanger ; une fille remue ciel et terre pour envoyer un médicament indispensable aux soins de son père, également empêché de revenir en Belgique, des binationaux ne sachant plus à quelle patrie se vouer…
Ces petits exemples de bribes de vies (de mort) sont venus nous rappeler les souffrances de l’exil, de la séparation avec leurs familles que subissaient, de plein fouet, les célibataires ayant franchi la Méditerranée pour s’installer, pour certains d’entre eux, comme mineurs, dans les corons. C’était il y a près de 6 décennies pour l’histoire de l’immigration belgo-marocaine.
Hier les corons, aujourd’hui le coronavirus. Une similitude des vocables qui dansent à l’unisson sur un refrain connu, orchestré par un virus à couronne invisible à l’œil nu qui a révélé, comme sous l’effet d’un miroir grossissant tous les affres de l’exil qui continuent de se perpétuer, au gré des générations.




 chargement...
chargement...