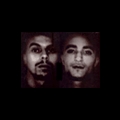Paru récemment aux éditions La Croisée des chemins, «Sacrées femmes, sur les pas des saintes du Maroc» de l’écrivaine et architecte Yasmina Sbihi ne prétend pas être un récit historiographique. Emprunt d’Histoire toutefois, de valeurs spirituelles et soufies, ce livre sur le ton d’une force tranquille montre le visage féminin de la sainteté islamique qui a façonné le Maroc, dans une tentative de proposer un récit émancipateur et fédérateur à la fois.
Ode à la gouvernance féminine, cet ouvrage aborde ainsi la question saillante de la participation des femmes, tout en l’encrant dans l’espace et dans le temps. Cette démarche apaisée déconstruit les dogmes et les perceptions stigmatisantes, notamment les interpétations religieuses réductrices sur la place de la femme dans la gestion de la cité et la création d’un leadership humaniste.
Comment votre intérêt s’est porté sur la figure féminine de la sainteté au Maroc ?
Dans mon cheminement spirituel personnel, il y a une présence féminine très forte, notamment ma relation avec sayyidatouna Khadija, sayyidatouna Mariam et l’icône Rabea el adawiyya. A chacune j’ai consacré une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube.
Ensuite, lors d’une ziara dans le Souss, j’ai été invitée à découvrir des waliyates et des madariss atiqa [medersas, ndlr], écoles fondées par des femmes et qui forment des hommes jusqu’à nos jours. Enfin, des questions d’actualité liées à la femme, qui se débat encore pour défendre ses droits, partout dans le monde en fait.

Vous remontez jusqu’à Ève et votre épilogue est consacré aux femmes modernes et contemporaines. Mais votre livre est plus délimité dans l’espace, entre Fès et le Souss. Quelle est la particularité des représentations spirituelles féminines sur cet axe ?
C’est un axe symbolique, matérialisé par deux pôles scientifiques et spirituels forts. Il met l’accent sur l’unité spirituelle du Maroc, sur tout le territoire, la richesse de notre patrimoine et la diversité culturelle, notamment les dialectes, les us et coutumes.
Ce que je veux dire aussi est que du nord au sud, tout le Maroc est une terre de lumière, «ard el awliyas», le royaume des saints, hommes et femmes de savoir et de prodiges. La seule chose qui distingue les femmes est qu’on n’en parle pas ou si peu.
Vous faites référence au soufisme, en vous focalisant sur les personnages féminins dans l’histoire de la religion musulmane dans le pays. Quels profils peut-on trouver dans ce livre ?
Si je fais référence au soufisme, c’est avant tout parce que c’est la spiritualité vivante au cœur de l’islam. Si on s’en réfère au hadith de Jibril, qui explicite notre religion, on y voit «al iman», la foi, «el islam» paix et acceptation et «el ihsan», le perfectionnement et la bienfaisance, c’est-à-dire un état de conscience supérieur de croire en Dieu comme si on Le voyait… Le soufisme est la science qui nous permet d’accéder à cet état-là. Plus simplement, l’islam c’est charia et haqiqa, dogme et spiritualité, et le soufisme nous achemine de la charia à la haqiqa.
Je focalise sur les personnages féminins, bien entendu, car c’est mon sujet. Mais je fais référence aussi à de grandes figures masculines, de grands maîtres et penseurs. Dans les références hagiographiques, j’ai pu découvrir de grandes figures féminines : des reines , des savantes, des cheffes de guerre, des saintes musulmanes et aussi des saintes juives, qui elles aussi sont peu connues. Et enfin, je parle des femmes d’aujourd’hui.
Tout mon travail a pour objectif d’offrir un nouveau regard sur la question du genre et proposer un argumentaire spirituel, pour répondre aux allégations machistes qui réduisent la femme à un rang si loin de sa réalité et de ses aptitudes.
Ce n’est pas le pan de l’Histoire du Maroc le plus documenté, ou du moins le plus accessible et connu. Avez-vous mis du temps à retracer l’existence de ces femmes ?
Disons que l’histoire est écrite par des hommes pour les hommes, ce qui fait que la femme y est évoquée accessoirement ; il est important de lui rendre justice. J’ai eu la chance d’être accompagnée, dans mes recherches, par des hommes du Savoir, justes et soucieux de montrer cette place qu’occupe la femme en islam et dans le soufisme plus particulièrement.
Alors on cherche, on voyage et on fait des rencontres. Bien entendu avec l’intention, «enniya», on se voit gratifié de facilitations divines : «tartibat rabbaniya», que certains appellent synchronicité. Ce travail m’a pris des années, le temps de trouver, comprendre, assimiler et de mûrir. Et enfin le temps de trouver un éditeur à l’écoute.
.jpg)
Il existe de plus en plus d’écrits sur les femmes ayant marqué l’Histoire de notre pays. Certains sont romancés, à défaut d’éléments recoupés, d’autres sont succins, faute de sources historiques à portée de main. Où se situe votre contribution ?
Mon approche n’est ni historique, ni anthropologique, ni sociologique, ni politique, ni religieuse. C’est un témoignage, fruit de mes rencontres. C’est mon périple que je raconte et qui n’engage que moi. Je suis avant tout architecte, donc je m’intéresse à tous ces aspects à la fois : je raconte le lieu et l’esprit du lieu, tel un devoir de mémoire.
Mon parcours soufi sera toujours mon filtre de lecture. Mon récit est à l’image de ce que je suis, tout simplement, une citoyenne engagée en quête de Vérité et dans le souci de la transmission et du partage.
Ceci dit, j’aime beaucoup aussi l’histoire de Zaynab reine de Marrakech, si bien raconté par Zakia Daoud.
Ces parcours spirituels déconstruisent principalement l’idée reçue que l’islam relègue les femmes au second plan de la gouvernance. Pensez-vous qu’un autre récit historique et méthodologique est possible ?
Je l’espère bien. Et il existe, celui des soufis en quête du Vrai et mû par un amour universel, non pas par une attitude sectaire et takfiriste. L’Histoire n’est pas figée, la religion non plus. Et le Soufi est le fils de l’instant. Le Coran est immuable mais l’interprétation est relative à l’individu, au contexte… Les grands oulémas nous expliquent qu’il existe plusieurs niveaux de lecture du Coran, qui a une apparence extérieure et une profondeur cachée qui elle-même peut avoir jusqu’à sept niveaux d’explications, selon un hadith.
C’est ce qu’on appelle «el ijtihad», la jurisprudence. Dans la jurisprudence, il y a de la prudence à demeurer juste, à respecter l’Esprit de la Lettre sacrée. Pensez-vous que Dieu soit injuste envers la femme ? Je ne le crois pas un seul instant. Mais les interprétations ont été détournées, et pas qu’en islam. C’est clairement l’œuvre de Satan, car une société qui est injuste envers la moitié de sa communauté est une société handicapée, bancale et donc fragilisée…

Je pense que la guerre des genres est stérile ; hommes et femmes se complètent. C’est la loi du Créateur. Je crois fermement en un féminisme serein, dans lequel on voit la femme exceller dans le leadership et reprendre petit à petit, avec le savoir, l’effort et la patience, la place qui est la sienne au cœur de la société. Je crois en le pouvoir transformationnel qu’elle exerce sur les cœurs. L’Amour est le pouvoir le plus efficient et le plus pérenne. Autrement dit, une gouvernance sans amour n’est pas durable. On ne peut obtenir l’attention des gens et partager une idée qu’en pénétrant leur cœur. L’esprit suit.
La compétence, la présence physique ou l’autorité ne suffisent pas, car l’amour et l’humilité sont les clés ultimes de la réussite dans cette gouvernance. La femme est tout ceci à la fois. Capable de créer, de gérer et de fédérer… par instinct d’abord, avec cette forme d’intelligence qu’est l’Amour. Les waliyates salihates sont nos modèles de leadership : tant de femmes y reconnaîtront leurs grand-mères et leurs mères. Elles s’y reconnaîtront aussi, discrètement, heureuses de leurs accomplissements et de l’image qu’elles véhiculent.




 chargement...
chargement...