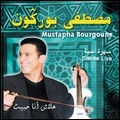Sollicités plus que jamais, en première ligne de front contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, les praticiens publics ne comptent plus ni les heures ni la charge de leur travail. Mercredi et jeudi, ils observent cependant une grève nationale, à l’appel du Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP). L’ensemble du dossier revendicatif de la structure est porté avec cette grève, ce qui rompt avec un retrait volontairement décidé depuis mars dernier.
Puisque le dialogue avec le ministère de tutelle «est au point mort» et que «même les conventions signées avec lui depuis août n’ont pas été mises en œuvre», le syndicat a en effet estimé que la situation «nécessitait l’observation d’une grève». «Cela ne signifie pas que l’activité hospitalière vitale pour nos citoyens est à l’arrêt, puisque les unités covid-19 et les services de réanimation ou d’urgence sont toujours assurés. Mais comme l’ensemble des voies possibles de dialogue ont été épuisées, nous devions organiser une nouvelle forme de mobilisation», a déclaré à Yabiladi El Mountadar Alaoui, secrétaire général national du SIMSP.
«Nous sommes dans l’incompréhension totale face à l’inaction du gouvernement qui, en plus de laisser lettre morte les accords signés, a ignoré pendant près de 20 ans, nos revendications comme a qualification de notre doctorat d’Etat conformément aux barèmes de la fonction publique, qui ne s’appliquent pas au secteur de la médecine», a rappelé le médecin.
Une charge de travail de plus en plus pesante
Cette grève intervient aussi dans un contexte où les médecins publics «sont réellement au bout du rouleau», selon le syndicaliste. La situation se ressent «particulièrement dans les zones reculées et celles les plus touchées par la pandémie, où faute de moyens humains, il arrive à un seul praticien de faire le travail de quatre confrères». Il rappelle que «les spécialités manquent et particulièrement en réanimation, alors que nous en avons le plus besoins actuellement».
Dans tout le Maroc, «on compte un peu moins de 300 réanimateurs pour 170 structures publiques à peu près, ce qui est évidemment insuffisant et illustre à quel point le corps médical est à bout de souffle aujourd’hui, en pleine pandémie». Il rappelle ainsi que «c’est lorsque au moment où nous avons eu besoin de nos médecins que nous avons réalisé qu’on n’en a plus formé assez, depuis bien longtemps».
En plus d’être peu nombreux, face au défi de la pandémie, le corps médical est aussi peu protégé contre les risques sanitaires auxquelles il est exposé en milieu hospitalier. Il y a une semaine, le Mouvement des infirmiers et des techniciens de santé au Maroc a alerté sur le manque de matériel de protection mis à la disposition des équipes, notamment les casaques et les blouses. Mais pour le secrétaire national du SIMSP, «ce n’est pas uniquement la pénurie du matériel en elle-même qui pose problème».
«Nous devons reconnaître que nous ne faisons pas partie des pays les mieux équipés dans le monde et la critique n’est pas sur ce sujet car plusieurs fois, le stock national disponible peut contenir tout ce qu’il faut. Mais des problèmes d’acheminement, de rationnement et de distribution interviennent. L’Etat fait des efforts pour préserver la santé des médecins en leur rendant disponible le matériel, mais l’opacité qui entoure l’accès à ces lots ne nous laisse pas définir réellement les responsabilités.»
«Ce qu’on peut dire en tout cas, c’est que des centaines de médecins, d’infirmier et d’aides-soignants ont été touchés par la pandémie du nouveau coronavirus», insiste par ailleurs El Mountadar Alaoui. «Certains regagnent leurs postes dès qu’ils en sont guéris. Des dizaines y ont succombé, ce qui ne nous fait pas pour autant reculer face à notre devoir professionnel, mais nous aurions souhaité que les données chiffrées sur le sujet soient publiquement annoncées», précise-t-il.
Des médecins en burn-out
Dans ces conditions, il estime que la charge du travail «peut être déduite des déclarations de nos ministres eux-mêmes, qui indiquent que 32 000 médecins manquent au secteur public, en plus de 57 000 infirmiers, soit un total de 99 000 compétences». Le syndicaliste décrit ainsi des médecins qui «travaillent sans compter les heures, en plus du fait que les spécialités peu nombreuses, comme les anesthésistes, sont désormais sollicités même en dehors de leur travail, puisque les hôpitaux n’en sont pas tous suffisamment dotés».
«A plusieurs reprises, nous avons assisté à des spécialistes mobilisés à distance auprès d’équipes médicales en besoin de compétences», affirme-t-il. «Ceci est sans dire qu’une importante partie de ces équipes est séparée de leur famille, par peur d'une contamination éventuelle», déplore encore le praticien.
Ceci pèse davantage sur le psychique du personnel médical, qui vit un stress intense depuis le mois de mars. «En temps normal déjà, la charge du travail dans la santé publique est lourde, faute de ressources humaines. Avec la pandémie, de nombreux collègues ont atteint un stade avancé d’épuisement au travail», nous décrit El Mountadar Alaoui.
«Certains praticiens ont été mis sous psychotropes pour pouvoir tenir, certains sont au bord du burn-out. D’autres encore ont développé des comportements addictifs plus qu’avant, alors que les congés ont été annulés cette année. Tous ces facteurs mènent donc à l’épuisement, que j’ai constaté moi-même au sein de mes collègues, certains ayant même tenté de se suicider.»
La situation est «particulièrement sensible chez les spécialités qui doivent gérer la mort plus souvent que d’autres médecins», comme dans l’oncologie, la réanimation, la prise en charge des maladies cardio-vasculaires ou le service des urgences. Dans ce contexte, «les anxiétés, les dépressions ou encore les comportements à risque s’accentuent», sans être toujours accompagnés.




 chargement...
chargement...