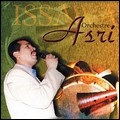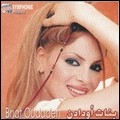Le département d'Etat américain a publié, hier, son rapport annuel sur la liberté de religion dans le monde pour l’année 2021. Le document, qui retrace les restrictions imposées aux minorités religieuses dans 200 pays à travers le monde, consacre une partie au Maroc. Le département américain y indique que les restrictions persistent pour certaines minorités.
Ainsi, il souligne que «les représentants des groupes religieux minoritaires ont déclaré que la peur du harcèlement sociétal, y compris l'ostracisme par les familles des convertis, le ridicule social, la discrimination à l'emploi et la violence potentielle à leur encontre par des extrémistes, étaient les principales raisons les poussant à pratiquer leur religion en privé et loin du public». Il revient sur l’affaire de l’Italo-marocaine Ikram Nazhi, condamnée pour «outrage et blasphème contre l'islam» sur les réseaux sociaux, pour des publications en 2019. «Le 28 juin, le tribunal de première instance de Marrakech l’a condamné à trois ans de prison et à une amende de 50 000 dirhams», poursuit la même source, rappelant que la ressortissante italienne d'origine marocaine a été libérée de prison le 23 août.
Le document cite aussi sur l’affaire de l'acteur de cinéma Rafik Boubker, arrêté en mai 2020 pour avoir tenu des propos blasphématoires contre l'islam et d'avoir attaqué le caractère sacré du culte. «Aucune date n'avait été fixée pour l'audience à la fin de l'année», alors que l’acteur a été remis en liberté provisoire.
L’année dernière aussi, les autorités marocaines ont continué à «refuser aux groupes chrétiens citoyens marocains le droit au mariage chrétien ou civil et aux services funéraires, ainsi que le droit de fonder des églises». «Le gouvernement a refusé la reconnaissance officielle des ONG qu'il considérait comme faisant campagne contre l'islam en tant que religion d'État», poursuit la même source.
L’islam en tant que religion d’Etat
Citant le gouvernement, le rapport indique, s’agissant de la religion musulmane, que 79 personnes ont été inculpées ou condamnées pour avoir commis des actes prohibés pendant le mois de Ramadan. De plus, les autorités continuent d’interdire, depuis 2017, la production et la vente de la burqa pour des «raison de sécurité». Le gouvernement a aussi continué d’exiger que les chefs religieux qui travaillaient dans le pays «respectent les directives énoncées dans le Guide de l'imam, du khatib et du prédicateur» publié par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Ce dernier «a continué de guider et de surveiller le contenu des sermons dans les mosquées, l'enseignement religieux islamique et la diffusion de matériel religieux islamique par les médias audiovisuels».
Le rapport évoque la surveillance des écoles coraniques et des restrictions sur la distribution de matériel religieux non islamique, ainsi que de certains matériels islamiques jugés «incompatibles avec l'école Maliki-Ashari de l'islam sunnite». La même source ajoute que «le gouvernement a continué à diffuser des informations sur l'islam et le judaïsme sur des chaînes de télévision et de radio financées par l'État».
Comme les années précédentes, le rapport met implicitement la lumière sur les disparités de traitement des différentes minorités religieuses au Maroc. Ainsi, il rapporte que «les dirigeants communautaires de divers groupes chrétiens ont déclaré que les autorités continuaient de passer des appels téléphoniques ou à domicile pour surveiller les activités des chrétiens». «Selon diverses sources, les autorités ont continué à expliquer que le but de cette surveillance était de protéger les communautés religieuses minoritaires» et de «surveiller le respect des restrictions liées au Covid-19 dans les lieux religieux», ajoute la même source.
Deux poids, deux mesures
Pour les Marocains convertis au Christianisme, le rapport note que l'Association marocaine des libertés religieuses, une organisation qui défend les droits des minorités religieuses ayant demandé son enregistrement en 2019 «n'était toujours pas enregistrée à la fin de l'année», tout comme une autre «association religieuse étrangère non musulmane». Le document souligne toutefois que «les dirigeants chrétiens ont continué à indiquer qu'il n'y avait aucun rapport faisant état de pression des autorités sur les convertis pour qu'ils renoncent à leur foi en informant des amis, des parents et des employeurs des conversions de l'individu». Mais «des médias, des militants, des dirigeants communautaires et des chrétiens convertis ont rapporté que des citoyens chrétiens subissaient des pressions sociales pour se convertir à l'islam ou renoncer à leur foi chrétienne», précise-t-on.
La même source fait aussi état du «refus du gouvernement d'autoriser les groupes musulmans chiites à s'enregistrer en tant qu'associations», soulignant que les autorités ont «continué d'empêcher ces groupes de se rassembler légalement pour des observations religieuses publiques». Le rapport rappelle qu’il «n'y a pas de mosquées chiites connues dans le pays», alors que les membres de la communauté chiite ont indiqué qu'ils n'avaient pas tenté de s'enregistrer au cours de l'année car ils «craignaient que les forces de sécurité ne les harcèlent, comme cela avait été le cas les années précédentes». Le document précise que «selon les membres de la communauté chiite, ils pouvaient prier dans les mosquées sunnites, mais ils risquaient d'être critiqués par d'autres fidèles pour leurs pratiques religieuses».
En revanche, lorsqu’il s’agit du judaïsme, le Département d'Etat américain rappelle que «les citoyens juifs ont continué à déclarer qu'ils vivaient et assistaient aux offices dans les synagogues en toute sécurité» et «ont déclaré pouvoir visiter régulièrement des sites religieux et organiser des commémorations annuelles». Le document indique aussi que «la monarchie a continué à soutenir la restauration des synagogues et des cimetières juifs dans tout le pays, des efforts qu'elle a déclaré nécessaires pour préserver le patrimoine religieux et culturel du pays et pour servir de symbole de tolérance». Et le département d'Etat américain de rappeler que «les musulmans sunnites et les juifs sont les seuls groupes religieux reconnus dans la Constitution comme natifs du pays».




 chargement...
chargement...