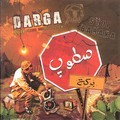Né en Belgique en 1971, de parents marocains ayant émigré à la fin des années 1960, Mohsin Mouedden a eu un long parcours associatif à Bruxelles. Aîné de trois sœurs et de trois autres frères, il grandit à Anderlecht. Il se rappelle que ses parents qui maîtrisent parfaitement l’arabe à l’oral comme à l’écrit étaient les rares chefs de famille lettrés dans son entourage. Mais comme beaucoup d’enfants dans sa situation, il n’a pas eu la chance de faire des études supérieures et quitte l’école avant d’obtenir son baccalauréat.
«La réussite était plutôt une exception et durant les années 1980, peu de jeunes issus de l’immigration accédaient à l’université. C’étaient surtout ceux qui n’étaient pas nés ici et qui venaient du Maroc pour continuer leurs études qui se distinguaient le plus», se souvient-il. Mohsin confie avoir fréquenté «un établissement parmi ceux qu’on appelait les écoles à discrimination positive et qui étaient connus par leur taux très élevé de violence».
«J’ai préféré abandonner les bancs de l’école qui consacrait les discriminations envers les enfants issus de l’immigration marocaine, turque, italienne ou espagnole, qui étaient les plus pauvres et les plus précarisés. Les problèmes sociaux, économiques et psychologiques se transposaient là-bas et les équipes pédagogiques n’étaient pas formées pour cela.»
Une formation par l’action associative
Si Mohsin n’aimait pas l’école, il cultivait un amour inconditionnel pour les livres. «Ma première bande-dessinée vers huit ans a été une révélation pour moi. La lecture m’a sauvé», nous confie le militant. Comme nombre de ses camarades, il reconnaît avoir séché plusieurs heures de cours, mais pas pour les mêmes raisons. «Je trouvais plutôt refuge à la bibliothèque des Riches Claires au centre-ville bruxellois. Je passais trois à cinq heures pendant que mes parents pensaient que j’étais en cours. Je lisais tout, des magazines aux romans, en passant par les biographies et les livres de géopolitique», se rappelle-t-il.

Parallèlement, son parcours militant a commencé à se dessiner. Il baigne dans les revendications civiques sur le droit de vote des immigrés et la lutte contre les discriminations. Dès ses 15 ans, il participe à des manifestations contre la loi Gol. «Il y avait aussi des crimes racistes au début des années 1980 que nous dénoncions et nous étions très sensibles à la cause palestinienne, particulièrement avec la première Intifada», nous déclare-t-il.
En quittant l’école, Mohsin Mouedden devient très vite autonome en travaillant. «En termes de métier, je suis passé pratiquement par tout ce qui pouvait exister, entre vendeur, pompiste, serveur dans des restaurants… Je me suis émancipé de la cellule familiale dès mes 18 ans».
En côtoyant des jeunes comme lui, il se pose des questions sur la non-réussite des populations migrantes dans le pays qui l’a vu naître. «Après 30 ans d’existence de nos communautés ici, nous étions nombreux à vivre encore sous le seuil de la pauvreté et cela nous a fait réfléchir. J’ai donc suivi une formation de trois ans pour devenir éducateur et j’ai commencé à travailler avec les jeunes, en mettant sur pied des activités et des projets civiques». Depuis, il a été coordinateur ou directeur d’organisation en Belgique.
Fortement inspiré par la figure de Nelson Mandela, Mohamed Ali ou encore Ghandi qui ont été ses «professeurs à travers leurs ouvrages et qui ont marqué [son] identité en tant que militant des droits humains», Mohsin crée en 1997 l’association Alhambra, suite aux révoltes d’Anderlecht.
«Avec un groupe de trois personnes, nous devions aussi parler au nom des jeunes qui se sont révoltés quelques semaines auparavant. Nous avions rencontré le ministre de l’Intérieur de l’époque pour lui remettant nos revendications.»
Au sein de son ASBL, l’idée est de «travailler sur la question identitaire dans les quartiers populaires, sur la question de la civilisation d’Al-Andalus, de manière à joindre l’identité occidentale et arabo-musulmane ou berbéro-musulmane». Dans ce cadre, il met en place un programme de formation pour les jeunes sur un an, avec des séances hebdomadaires. «A la clé, il y avait un voyage pour aller à la rencontre de syndicalistes espagnols, les travailleurs sous les serres andalouses et visiter le patrimoine islamique et juif de Cordoue, de Séville et de Grenade», explique le militant.
Un engagement pour la cause palestinienne qui lui vaut des menaces
Ses expériences associatives le conduisent à créer le Mouvement Citoyen Palestine (MCP) en 2002, pendant le siège de la Moukataa contre le président Yasser Arafat. «A ce moment-là, une partie du monde politique belge a eu peur de mes positions et j’ai commencé à ressentir des oppositions féroces de la part d'élus de la diversité eux-mêmes, après les avoir relancés sur leur position concernant le conflit israélo-palestinien», se souvient-il.

Pendant les bombardements israéliens contre Gaza en 2008-2009, Mohsin travaille à la radio arabe de Bruxelles (Al Manar) et au Journal du Mardi. Mais son militantisme lui vaut une exclusion de la radio où il a officié pendant dix ans, et des attaques de la part de politiques.
Après cette période «très dure à gérer sur le plan émotionnel et psychique», Mohsin prend du recul à partir de 2009. «J’étais continuellement sous le coup de menaces de mort et d’insultes publiques, sans avoir de grand soutien politique», regrette-t-il. Mais la cause palestinienne reste «chère à [son] cœur», ce qui lui fait d'ailleurs regretter la récente normalisation entre le Maroc et Israël. En 2010, il prend ses distances avec son activité militante, après cinq ans d’engagement également au sein du Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX), où il a travaillé sur les questions d’islamophobie.
Un retour pour obtenir le rapatriement des Belgo-marocains bloqués au Maroc
Mais dix ans plus tard, Mohsin Mouedden reprend du service, initiant le groupe des Belgo-marocains et des Marocains résidents en Belgique et bloqués au Maroc, à cause de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du nouveau coronavirus. Ce retour s’est fait au moment où il s’y attendait le moins.
«J’étais assistant parlementaire pour une sénatrice écologiste et je venais juste de quitter mes fonctions, lorsque le confinement sanitaire a été annoncé en Belgique. Je me disais donc que cette période allait me permettre de me reposer. Puis j’ai été contacté par une amie socialiste, qui m’a demandé de l’aide car son fils était bloqué à Tanger. De fil en aiguille, j’ai créé un groupe sur Facebook pour voir comment on pouvait aider d’autres personnes qui se trouvaient dans la même situation.»
Mohsin Mouedden reçoit une avalanche de messages, de mails et d’appels. Les Belgo-marocains bloqués au Maroc se comptent alors par milliers. «Nous avions fait un courrier au roi Mohammed VI, saisi le chef du gouvernement marocain, le ministre des Affaires étrangères au Maroc, celui de l’Intérieur, les fondations institutionnelles, mais rien n’y faisait. La personne qui m’a rapidement rappelée du côté marocain a été l’ambassadeur Mohamed Ameur», se rappelle-t-il.
 Le petit Raith a pu être rapatrié après plusieurs refus de la part de la Belgique, resté séparé de sa mère qu'il devait rejointe avec son père
Le petit Raith a pu être rapatrié après plusieurs refus de la part de la Belgique, resté séparé de sa mère qu'il devait rejointe avec son père
«Je dormais quatre heures par jour et je devais rester disponible pour toutes les sollicitations, quotidiennement. J’ai été dans un épuisement moral et psychologique difficiles à mesurer, complètement dépassé par les demandes. Mais il était impossible de les ignorer, car des liens se sont tissés et je considérais toutes ces personnes comme des membres de ma famille, surtout lorsqu’on voit que beaucoup sont des personnes âgées ou malades.»
A la suite des action de Mohsin auprès des députés, le chef de la diplomatie belge Philippe Goffin «est interpellé sur la question au Parlement chaque mardi, de la part toutes les tendances, ce qui l’a poussé à prendre des décisions». «Après de gros efforts de pression avec l’aide de politiques et des médias, nous avons pu obtenir plusieurs rapatriements en coordination avec les autorités des deux pays ainsi que des compagnies aériennes, jusqu’au mois de juillet», décrit-il en qualifiant cette période d’intense «ascenseur émotionnel».
Au cours de ces mois, beaucoup d’histoires humaines de Marocains vivant en Belgique ont été émouvantes, notamment «le rapatriement difficile du petit Raith resté cher sa grand-mère à Tétouan, que la Belgique ne voulait pas rapatrier et pour qui nous sommes passé via le ministre marocain des Affaires étrangères pour qu’il arrive chez ses parents, le jour de l’Aïd el fitr». Les internautes se rappellent également des retrouvailles de Reda, 16 ans, avec son petit frère, après une longue séparation. Depuis, les actions du groupe se sont élargies pour englober les Belgo-maghrébins qui militent pour leurs droits et libertés.




 chargement...
chargement...